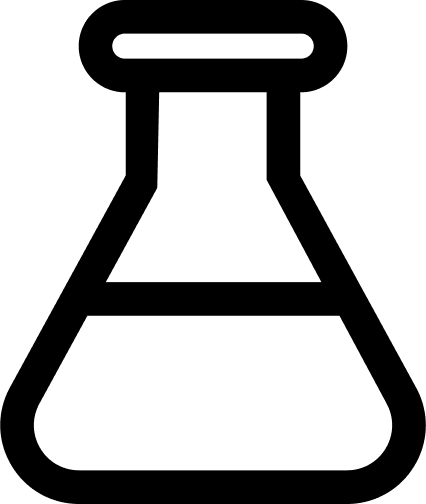La sobriété numérique est devenue un mot d’ordre dans les institutions et dans les entreprises de médias. En France, le numérique représente déjà une part significative de l’empreinte carbone nationale. Pour les groupes audiovisuels, la contradiction est frontale : tout le modèle repose sur la vidéo en ligne, le replay, les plateformes de streaming et, désormais, l’intelligence artificielle. L’infrastructure qui soutient cette économie, les data centers, se retrouve au centre d’injonctions parfois contradictoires.
La question n’est plus de choisir entre innovation et sobriété, mais de savoir comment organiser techniquement les services pour limiter la casse énergétique. Derrière les homepages et les applications mobiles, les décisions d’architecture, les choix d’hébergement, de stockage ou de mise en cache ont un impact concret sur la consommation d’électricité et les émissions associées.
Sobriété numérique : un nouveau cadre pour les médias
En 2025, l’ADEME et l’ARCEP rappellent que le numérique pèse environ 4,4 % de l’empreinte carbone de la France, selon la mise à jour de leur grande étude sur l’impact environnemental du numérique pour l’année 2022. Près de la moitié de cet impact proviendrait désormais des data centers, alors que la précédente évaluation n’en attribuait qu’environ 16 %, car les hébergements à l’étranger n’étaient pas pleinement pris en compte. Ce changement de focale renforce la pression sur tous les acteurs, médias compris.
Dans le même temps, le gestionnaire de réseau RTE estime que la consommation électrique des data centers français, aujourd’hui autour de 10 TWh par an, pourrait atteindre entre 23 et 28 TWh en 2035, soit environ 4 % de la consommation totale du pays si aucune inflexion n’est apportée. Pour des groupes qui revendiquent leur rôle dans la transition écologique, difficile d’ignorer une telle dynamique.
Concrètement, les médias se retrouvent à l’intersection de plusieurs textes et feuilles de route : loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique, plan de sobriété énergétique, chartes internes de responsabilité sociale. Les directions techniques doivent intégrer ces contraintes dans leurs roadmaps : mutualisation des environnements, rationalisation des serveurs, éco-conception des sites et limitation des fonctionnalités les plus lourdes en données.
Dans ce contexte, les stratégies de numérique responsable servent de fil directeur. Elles combinent mesure de l’impact, choix d’infrastructures plus sobres et arbitrages d’usage, avec une montée en puissance de référents green IT et un dialogue plus serré entre DSI, directions RSE et rédaction.
Dans les coulisses des data centers des groupes français

Depuis quelques années, les grands acteurs audiovisuels français ont commencé à réorganiser leurs infrastructures. France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et TV5 Monde ont par exemple choisi de s’appuyer sur le data center français Thésée pour une partie de leurs besoins cloud, avec l’objectif d’optimiser les moyens techniques tout en améliorant la performance énergétique. Cette stratégie s’accompagne d’un travail sur l’écoconception des plateformes, présenté comme un axe central de la transformation numérique du groupe.
Chez TF1, le levier principal a longtemps été le stockage. En modernisant ses baies utilisées pour la production et la diffusion, le groupe a annoncé une réduction de 42 % de l’énergie consommée sur ce périmètre et une baisse de moitié de l’occupation au sol dans le data center, tout en augmentant la capacité totale de stockage. Ce type d’investissement illustre une logique simple : mieux utiliser chaque watt pour stocker et distribuer des volumes de données toujours plus élevés.
Derrière ces exemples se cache une tendance plus générale : la bascule vers des architectures hybrides, partagées entre data centers spécialisés bas carbone et clouds publics internationaux. Les pics de trafic, typiques des soirées électorales ou des grandes émissions de divertissement, sont absorbés par des services de scalabilité automatique, tandis que les briques critiques et les archives restent sur des infrastructures plus maîtrisées.
Pour les équipes techniques, cela signifie aussi travailler finement les formats, les encodages et les workflows. Dans les services d’archives, par exemple, l’uniformisation des fonds audiovisuels nécessite de convertir des fichiers très hétérogènes vers un format plus standard. C’est dans ce type de chaîne de traitement que l’usage d’un convertisseur mp4 prend tout son sens, en offrant un format de référence pour les exports, l’archivage et les rediffusions web.
Vidéo, IA et optimisation des flux : arbitrer au millimètre

La contrainte énergétique arrive au moment même où la vidéo s’impose comme usage dominant. Greenpeace, en s’appuyant sur les travaux du Shift Project, rappelle que le streaming vidéo représente à lui seul environ 60 % des flux de données sur internet et près de 1 % des émissions mondiales de CO2. Les médias français ne sont donc qu’un fragment d’un phénomène global qui tire les infrastructures vers le haut.
Dans leurs data centers et leurs clouds, les groupes médias travaillent désormais la granularité de chaque flux. Là où une seule version d’un programme était autrefois stockée, les plateformes conservent aujourd’hui des variantes multiples : qualité standard, haute définition, parfois 4K, extraits pour les réseaux sociaux, déclinaisons verticales pour mobile. Chaque version supplémentaire a un coût en stockage et en bande passante. L’usage raisonné d’outils de transcodage et d’un convertisseur mp4 commun permet de réduire les duplications inutiles tout en conservant la qualité perçue.
L’arrivée de l’IA ajoute une couche de complexité. Sous-titrage automatique, recommandation personnalisée, génération de résumés, indexation sémantique des archives : autant de services qui reposent sur des entraînements et des inférences gourmandes en calcul. Les directions techniques évaluent désormais l’intérêt éditorial d’une nouvelle fonctionnalité au regard de son coût énergétique, et certaines tâches peuvent être décalées dans des créneaux où l’électricité est moins carbonée.
Côté production éditoriale, les workflows sont eux aussi revisités. Pour préparer un sujet destiné aux réseaux sociaux, une rédaction peut chercher à limiter le poids global du dossier : sélectionner moins de rushes redondants, réduire la durée des exports, compresser les miniatures. Dans ce cadre, une équipe web peut s’appuyer sur un outil grand public pour compresser les jpg et utiliser un convertisseur mp4 dans une même interface, par exemple avec Adobe Express, afin de préparer rapidement des fichiers adaptés aux plateformes sans repasser par les usines de transcodage internes.
Enfin, la généralisation du caching et des CDN reste un levier clé. En rapprochant les contenus des utilisateurs finaux et en évitant des allers-retours permanents vers le data center d’origine, les médias réduisent la charge réseau et l’énergie nécessaire pour livrer chaque flux. Le réglage des durées de cache, la mutualisation des contenus statiques entre marques d’un même groupe et l’optimisation des routes réseau deviennent des sujets aussi stratégiques que la typographie ou le placement de la publicité.
Encadré : 5 pistes techniques pour réduire l’empreinte d’un site média
Mesurer systématiquement le poids moyen des pages, le taux d’activation des vidéos, les temps de chargement et la consommation serveur, pour piloter les actions sur des données réelles.
- Réduire le transfert de données côté front : formats d’images plus efficaces, chargement différé des médias, limitation des scripts tiers de tracking et des players embarqués superposés.
- Optimiser le player vidéo en désactivant la lecture automatique non indispensable, en proposant une qualité par défaut raisonnable et en adaptant plus finement le débit à la connexion réelle.
- Rationaliser les environnements techniques en éteignant les plateformes de test inutilisées, en mutualisant les briques transverses et en modernisant progressivement les baies de stockage.
- Travailler la stratégie CDN et cache, en partageant les contenus statiques entre marques et en ajustant les durées de conservation au plus juste selon la nature des pages.
Conclusion : vers une sobriété sous contrainte
Au vu de ces éléments, la sobriété numérique dans les médias français ne ressemble pas à une décroissance assumée des usages. Le streaming progresse, la vidéo courte envahit les écrans et l’IA devient un standard concurrentiel. L’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a par exemple comptabilisé plus de 28 milliards de visites sur les sites et applications de presse en 2024, dont une majorité en format numérique, ce qui illustre cette mutation de long terme. Culture Gouvernementale
La réponse passe donc par une discipline technique plus fine que par un renoncement frontal. Les groupes audiovisuels cherchent à faire plus, mais surtout à faire mieux : moderniser les infrastructures de stockage, choisir des data centers plus sobres, limiter les duplications, encadrer les fonctionnalités les plus coûteuses et travailler l’écoconception des interfaces. Ce travail est souvent invisible pour le public, mais il conditionne la possibilité de maintenir un service riche sans exploser l’empreinte carbone.
Pour les rédactions et les équipes produits, la question devient aussi éditoriale : quel niveau de qualité est réellement nécessaire sur mobile, faut-il lancer automatiquement chaque vidéo, combien de temps conserver les formats éphémères ? Chaque arbitrage technique porte une dimension de sobriété. À terme, la capacité des médias français à concilier innovation et responsabilité se jouera autant dans leurs data centers que dans leurs conférences de rédaction.
FAQ
Les data centers des médias sont-ils vraiment un gros poste d’émissions ?
Oui, car ils stockent et distribuent massivement de la vidéo et des services numériques. Leur consommation électrique progresse vite, ce qui en fait un enjeu central des plans de sobriété.
Pourquoi la vidéo est-elle autant ciblée dans les stratégies de sobriété numérique ?
Parce qu’elle représente la majorité du trafic de données et que chaque minute visionnée mobilise du stockage, de l’encodage et de la bande passante, bien plus qu’une simple page web.
Les médias français rapatrient-ils leurs données sur des data centers nationaux ?
Ils utilisent plutôt des architectures hybrides, en combinant des data centers français bas carbone pour les briques critiques et du cloud international pour absorber les pics d’audience.
L’IA rend-elle la sobriété numérique impossible pour les médias ?
Non, mais elle complique l’équation. L’IA consomme beaucoup de calcul, tout en offrant des gains potentiels d’efficacité. L’enjeu est de réserver ces usages aux services réellement utiles éditorialement.
En tant qu’internaute, peut-on réduire l’impact de la consommation de médias ?
Oui, en désactivant la lecture automatique, en limitant la très haute définition quand elle n’est pas nécessaire et en évitant de laisser tourner des vidéos en arrière-plan sans les regarder.